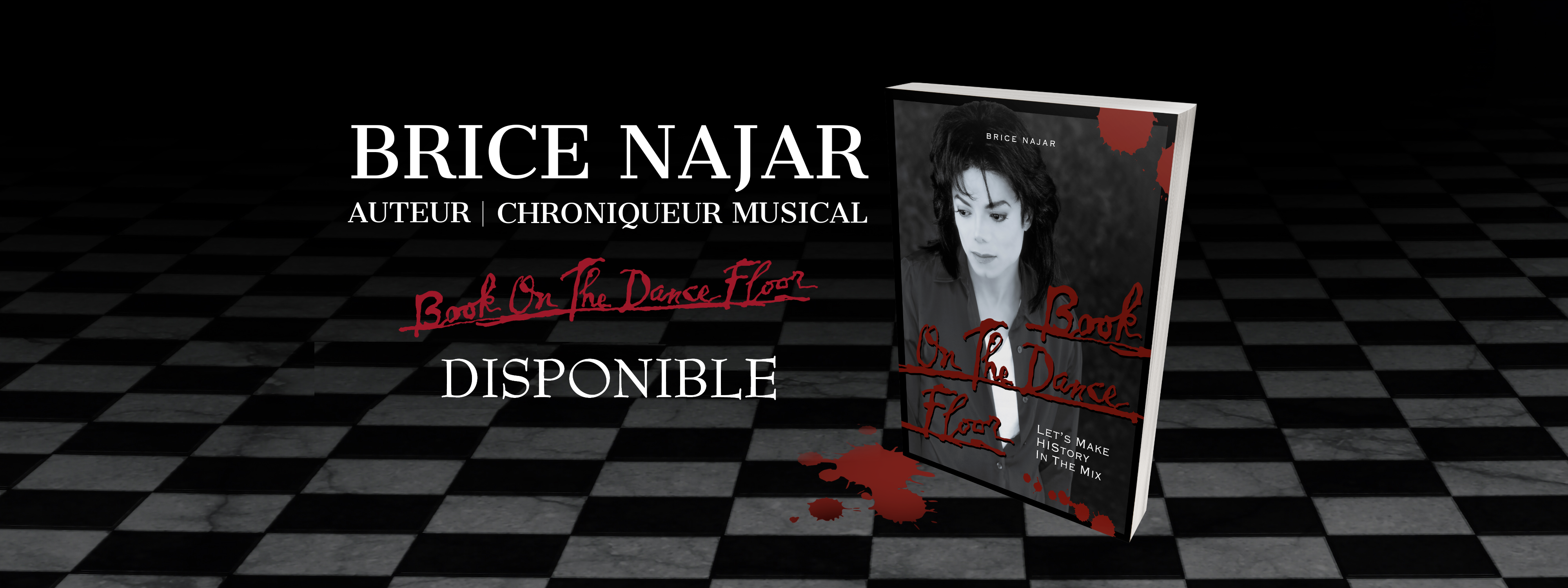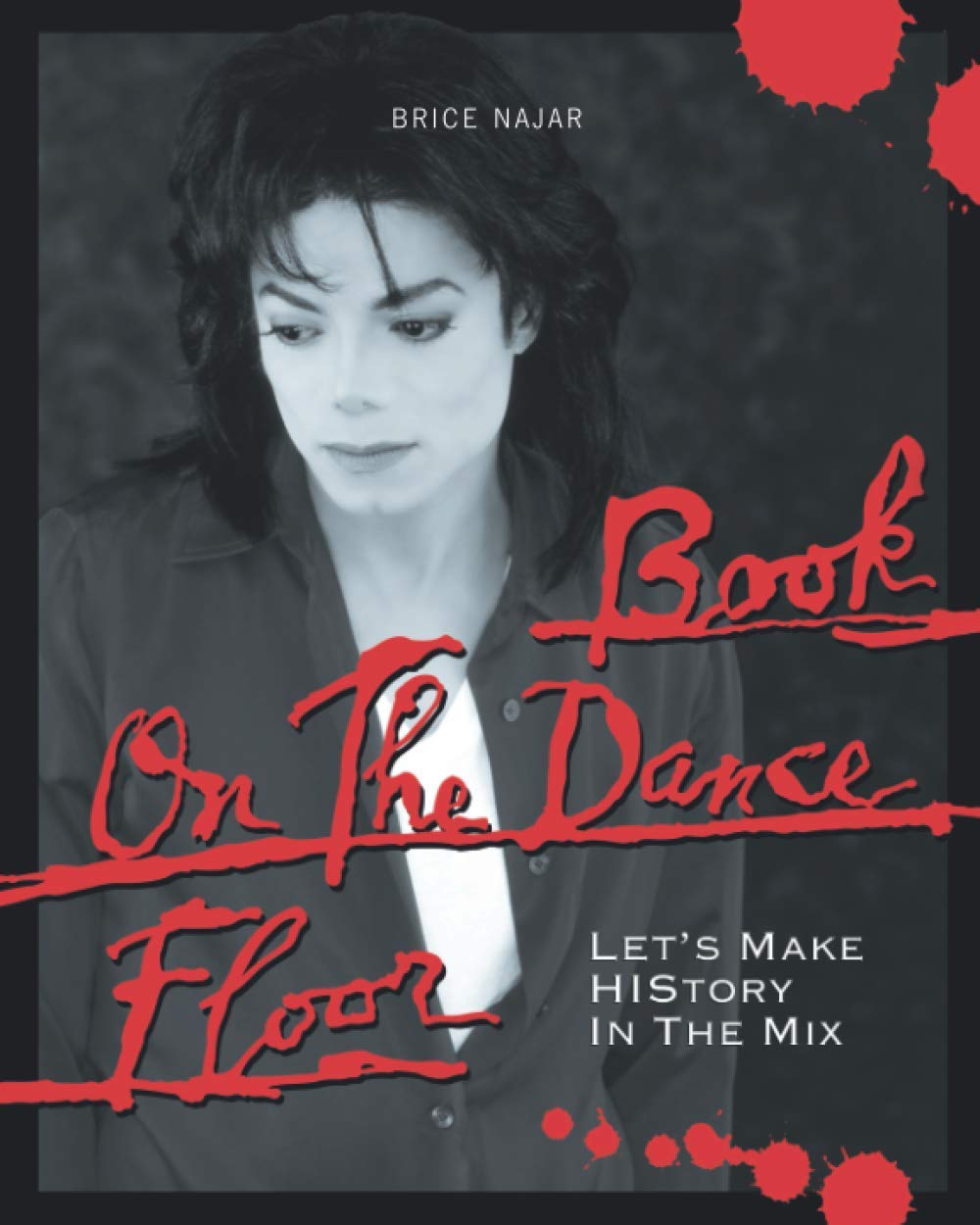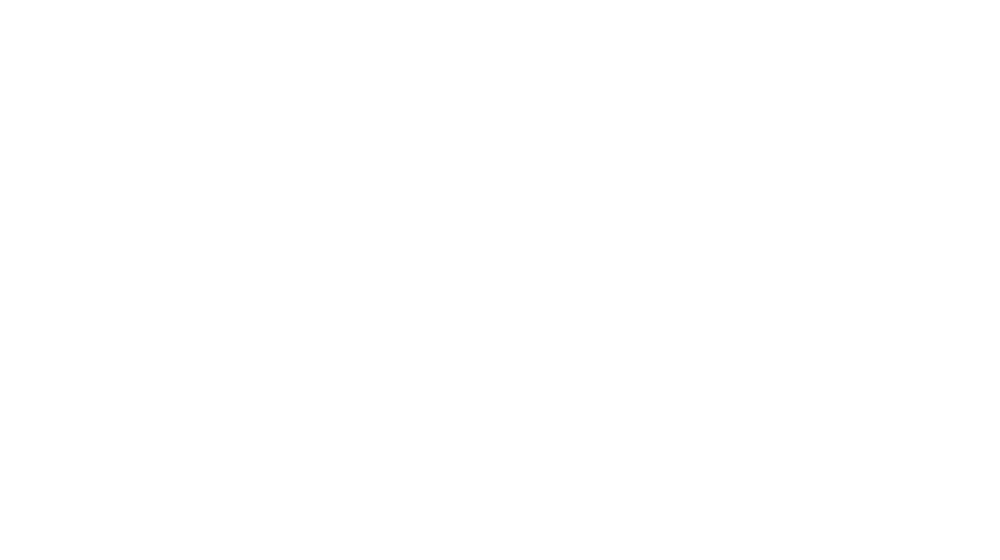.
John Luongo
Une réédition des albums des Jacksons avec des suppléments, c’est malheureusement trop peu fréquent. On peut donc considérer à leur juste valeur ces nouvelles parutions de Destiny et Triumph en 2008 avec des mixs de John Luongo. Il est vrai que ces versions alternatives de Blame It On The Boogie, Shake Your Body et Walk Right Now nous replongent dans l’époque de ces premiers maxis 45 tours avec un menu de ce type dont sont friands les collectionneurs de vinyles. Je voulais donc me replonger dans cette période, et rien de mieux pour le faire que de discuter avec ce talentueux DJ et producteur. J’en profite pour remercier mon ami Dams Pap car nos discussions m’ont aidé à préparer cet entretien avec John Luongo afin qu’il nous raconte ses nombreux souvenirs.
Comment vous est venue cette passion de DJ et de remixer au point d’en faire votre métier ? Pouvez-vous nous raconter vos débuts dans cette voie ?
J’ai grandi à Boston et j’ai toujours aimé la musique. J’écoutais tous les styles de musique à la radio et ce qui m’intéressait, c’était les sons : j’adorais le Rock, le R’n’B, le Funk, le Jazz, la Pop, tout ce qui me passait à portée d’oreilles pourvu que ça soit intéressant et que ça sonne bien ! Peu importe si c’était des ballades ou des rythmes rapides puisqu’ils me touchaient tous d’une manière différente, unique, intéressante et positive. Un jour, alors que je passais d’une station à l’autre sur mon petit poste FM, je suis tombé sur une station Afro-Américaine qui n’émettait qu’à partir de minuit et qui était pilotée par des étudiants noirs très talentueux de l’université du MIT (l’Institut de Technologie du Massachusetts). L’émission ne durait que trois heures mais elle était très novatrice car il n’y avait pas de playlist pré-déterminée ce qui comblait un gros manque dans la communauté musicale. En effet, la seule autre station de radio de la ville à jouer du R’n’B était une station AM qui s’appelait WILD mais ils devaient quitter l’antenne à 19 heures chaque soir du fait de restrictions imposées par la FCC, et ils ne la reprenaient que vers 8 ou 9h le matin pour passer du Gospel pendant la première heure, conformément aux obligations locales. A l’inverse, WTBS FM était une station universitaire installée dans le sous-sol d’un des bâtiments du MIT et c’était l’un des seuls endroits, en dehors de quelques autres stations du même type, où on pouvait entendre de la super musique R’n’B, non-commerciale et non-censurée.
Ils prenaient l’antenne à midi avec une émission qui s’appelait « The Ghetto » en l’honneur de l’immense chanson de Roberta Flack et Donny Hathaway. C’était un super format avec du R’n’B « pur jus » : The Ebonys, The Last Poets, The Moments, Whatnauts, Mandril, The Escorts et plein d’autres grands groupes… de la musique intéressante mais aussi par moments, un peu obscure et merveilleuse. Je mettais un de mes écouteurs dans mon oreille et je rabattais la couverture sur ma tête de façon à ce que mes parents ne s’aperçoivent pas que j’écoutais s’ils entraient dans ma chambre car ils voulaient que je dorme pour aller à l’école ! J’imagine que ça m’a conditionné à aimer et comprendre la musique dès mon plus jeune âge. (rires) Je m’endormais donc en écoutant cette musique, et je pense que, de manière subliminale, j’ai fini par en acquérir une grande connaissance ce qui a eu un incroyable impact sur moi et sur mon avenir musical. Je n’envisageais pas de faire une carrière dans la musique quand j’ai choisi mon orientation dans un premier temps : en fait, je suis allé à l’Université Northeastern de Boston, tout d’abord pour devenir ingénieur industriel, puis j’ai dévié vers la mécanique pour finir dans le génie civil. Là-bas, on pouvait rejoindre la station de radio et passer des disques via le réseau inter-campus qui diffusait dans toutes les parties du campus. C’était plutôt cool : tous les étudiants pouvaient l’écouter en mangeant ou en se détendant entre les cours. On n’avait pas le droit de parler à l’antenne, seulement de diffuser de la musique et de dire « WNEU », c’est tout. Alors, je jouais Deep Purple, Jimi Hendrix, the Beacon Street Union et ELP, que des artistes très en vogue à l’époque. De jour en jour, je devenais accro et de plus en plus drogué à la musique ! Il devenait évident que mon éducation me menait dans une direction mais que mon coeur en suivait une bien différente, doucement mais sûrement.
Un jour, avec des amis, nous avions décidé de faire une pause dans la montagne de devoirs que nous avions à faire et d’aller nous détendre. Nous sommes allés dans un endroit situé sur Beacon Street, à Boston. Si vous regardez la série tv Cheers, il y a un lieu qui s’appelle le Bull and Finch Pub : cet endroit existait vraiment mais c’était plutôt un pub anglais où les gens jouaient aux fléchettes. Ce pub se trouvait au sous-sol du bâtiment en question, mais deux étages au-dessus, il y avait un club, The Townhouse, et j’y suis monté avec mes amis car nous avions entendu de la musique qui provenait d’une ancienne bibliothèque : le lieu était désert. Il y avait une cabine en bois à un mètre du sol d’où un disc-jockey passait de la musique et nous avons jeté un oeil à la pièce tout en profitant de la musique qui nous plaisait bien. J’ai rassemblé mon courage et je me suis approché de la cabine du DJ pour lui dire : « C’est génial ! Mon nom est John Luongo et je suis DJ à l’Université Northeastern. J’adorerais faire ça ! » Alors que nous nous apprêtions à partir, je me suis de nouveau approché de Peter, le DJ, et je lui ai donné mon nom écrit sur une boîte d’allumettes en disant : « Si jamais vous avez besoin de quelqu’un pour vous remplacer un jour, prévenez-moi ! » Deux semaines plus tard, j’ai reçu un coup de fil de Jim, le gérant, qui m’a dit : « Peter, le disc-jockey, est parti et il nous a donné votre numéro comme celui de quelqu’un qui pourrait prendre la suite. » (rires) Bien entendu, j’ai répondu : « OUI ! Quand est-ce que vous avez besoin de moi ? » Ce à quoi, il a répliqué : Vendredi prochain, donc si vous pouviez passer un ou deux jours avant, qu’on discute ! » J’ai pensé : « Oh, punaise ! Dans quoi je me suis fourré ? »
Un peu en panique, je suis allé chez un disquaire du coin, Everett Music, situé à Everett dans le Massachusetts, la ville où j’avais grandi, et j’ai acheté des disques de toutes sortes : The Isley Brothers, Billy Preston, des artistes de la Motown, Crazy Elephant, Mitch Ryder, tout ce qui me semblait susceptible de faire danser les gens et de leur plaire. Puis, je suis allé au club et je me suis aperçu avec horreur qu’il n’y avait pas de système pour caler les morceaux, c’est à dire qu’on pouvait jouer soit la platine de gauche, soit celle de droite, mais si on voulait écouter ce qui allait suivre, ce n’était pas possible à moins de le balancer dans les enceintes du club ! GENIAL !!! C’était absolument ingérable, et n’importe quel DJ vous le dirait. On pouvait jouer les deux platines ensemble, mais il n’y avait pas de signal de calage au casque et on ne pouvait pas entendre le prochain morceau qu’on avait choisi de jouer pendant que le précédent passait. Vous parlez d’une pression !!! J’étais donc obligé de venir très tôt au club avec mes disques mais aussi un marqueur noir, car j’avais conçu un système pour surmonter ces obstacles. Je montais le volume et je faisais tourner le disque jusqu’à ce que j’entende le premier grésillement du morceau que je voulais jouer. Là, je faisais une marque sur l’étiquette centrale et je reculais le disque d’un quart de tour environ, de façon à savoir où le morceau démarrait quand je le lançais mais aussi que la musique commence en une seconde. Je savais que lorsque j’entendais le premier grésillement, c’était la première note de la chanson donc je n’avais qu’à reculer le disque d’un quart de tour, compter « Un, deux », appuyer sur le bouton « start » et la musique démarrait à « trois » comme je l’avais décidé ! Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis devenu très bon à cet exercice de mixer sans casque. Je défie quiconque de trouver un autre DJ capable de faire ce que je faisais dans ces conditions défavorables. Ce n’était pas très joli mais ça fonctionnait, et c’est ce qu’il faut faire quand on est vraiment motivé et qu’on veut quelque chose !
Ce n’était pas facile car le seul moyen de savoir à quel moment arrivait le morceau suivant, c’était d’utiliser l’autre platine et pendant qu’une chanson jouait, de mettre le volume aussi bas que possible pour pouvoir entendre le premier grésillement et reculer d’un quart de tour. C’est grâce à ces débuts très humbles que j’ai pu me construire une belle réputation parmi mes pairs et devenir le premier DJ de Boston et de Nouvelle-Angleterre (et peut-être même du monde à cette époque !) à être capable de mixer des disques sans coupures en passant d’une platine à l’autre et de façon à ce que personne ne puisse dire à quel moment je passais de la partie 1 à la partie 2 d’une chanson. C’était un vrai avantage pour les gens qui venaient m’écouter car normalement il leur fallait attendre que l’album sorte pour entendre les versions en entier mais moi, je leur les faisais écouter des semaines avant la sortie officielle à l’aide de deux 45 tours promos que j’associais comme s’ils ne faisaient qu’un ! Je l’ai fait avec le morceau Do It Again de Steely Dan, Whose That Lady des Isley Brothers, I’ll Always Love My Mamma des Intruders et bien d’autres !
De cette façon, je suis devenu de plus en plus connu ! Le club était blindé et les gens faisaient la queue dans les escaliers et jusqu’au coin de la rue pour entrer. Même si j’aimais ce que je faisais, ce n’était facile pour moi car j’allais à l’université la journée et le weekend, j’allais au club de bonne heure pour y faire mes devoirs, j’apportais mes disques, je mangeais sur place et je jouais jusqu’à 2 heures du matin. C’était beaucoup de boulot mais ça ne me gênait pas le moins du monde et je ne me suis jamais plaint à qui que ce soit. Au bout de cinq ans, j’ai obtenu mon diplôme et j’ai commencé à travailler dans le génie civil et j’ai accompli l’exploit de monter un immeuble de 8 étages et de 175 appartements à Westborough, une banlieue à 20 minutes de Boston, en 11 mois. C’était un record. Le chef de chantier et dirigeant de l’entrepris de construction m’a dit : « Tu vas devenir une pointure ! Bientôt, tu monteras un immeuble de 22 étages à Worchester ! » Mais ce n’était PAS une bonne nouvelle pour moi car j’étais pris entre deux choses et je me suis dit : « Tu sais quoi, John ? Tu n’as plus envie de faire ça. Tu ne vas pas continuer à monter des immeubles les uns après les autres. Ce que tu aimes, c’est la musique et ça te manque quand tu n’en fais pas ! » Alors, après une petite introspection, j’ai démissionné et j’ai dit à mes parents que j’étais allé à l’université et que j’avais eu mon diplôme, que j’avais travaillé pour remplir mes obligations comme je le leur avais promis, que j’avais gagné 250$ par semaine comme je l’avais imaginé et que j’avais fait ce que j’avais à faire, mais que là, j’allais prendre un grand virage dans ma vie et devenir DJ pour 125$ par nuit, mais que je m’en fichais parce que je voulais juste faire ce que j’aimais et c’était de la musique. Pour ma mère et mon père, ça a été un choc car ils ne savaient pas vraiment en quoi consistait le métier de DJ, ni combien on pouvait gagner, et d’ailleurs, moi non plus à l’époque ! En persévérant dans ce domaine, je suis devenu vraiment bon et de plus en plus connu car ma réputation de visionnaire et mon influence grandissaient à vitesse grand V. Pourtant, à un moment donné, j’ai eu quelques soucis avec les responsables du club où j’avais démarré : ils étaient furieux car je faisais tout le temps danser les gens ! Ils ne s’asseyaient jamais pour boire un verre, mais dansaient toute la soirée et se lâchaient complètement en suivant les montagnes russes émotionnelles sur lesquelles je les menais !
Pour moi, c’était super mais pour les barmen et les propriétaires du club, c’était un problème ! On m’a dit : « Il faut que tu joues plus de chansons lentes. Joue Brandy de Looking Glass pour vider la piste ! » J’ai répondu : « Vous êtes dingues ? Je suis disc-jockey ! Je fais bouger et danser les gens ! » On s’est un peu pris le bec et j’ai annoncé : « Bon, si vous essayez de me dire que je dois empêcher les gens de danser, alors je ne peux pas travailler ici. » Sur ce, je suis parti et j’ai commencé à chercher un autre boulot. Peu de temps après, j’ai entendu parler d’un club dans le quartier des affaires qui recherchait un DJ. C’était un club pour hommes d’affaires blancs, The Rhinoceros, dans le centre ville de Boston. Ils cherchaient un disc-jockey pour jouer après les services du midi et du soir, et ils m’ont proposé un entretien. Le propriétaire, Jackie Gateman, m’a tout de suite apprécié et j’ai été embauché. Une fois de plus, je me suis retrouvé avec les pires platines du monde !! Je pense que Dieu avait dû se dire : « Tu sais quoi, John ? Je vais te tester encore une fois et te donner des platines encore pires que les précédentes ! » C’était des A/R mais au moins, il y avait un système de mixage donc je pouvais enfin écouter une chanson au casque pendant qu’une autre passait. L’inconvénient, c’est que pour modifier la vitesse de la platine, il fallait soulever le lourd plateau en métal et déplacer un élastique d’une poulie à l’autre ! A ce moment-là, je me suis dit : « Mon Dieu, pourquoi ne m’aimes-tu pas ? Qu’est-ce que je t’ai fait dans une autre vie pour mériter ça ? » (rires)
Face à ce nouveau défi impossible, j’ai usé de mon ingéniosité et j’ai inventé un moyen de caler mes disques en découpant la pochette intérieure des albums et en mettant du silicone sur les plateaux de façon à caler les albums et les 45 tours. Je découpais la pochette en cercle et je vaporisais le plateau avec une bombe de silicone de façon à ce que le papier glisse avec le mouvement du plateau et permette ainsi au disque de rester immobile jusqu’à ce que je le laisse et que la musique démarre. Voilà, l’astuce pour caler les disques à la Luongo ! Mais aujourd’hui, je me rends compte que si je jouais un album et que je voulais ensuite passer un 45 tours, qui durait 3 minutes ou un peu moins, il fallait que je me rue sur l’autre platine, que je soulève le plateau pour changer l’élastique, que je remette le plateau, que je l’enduise de silicone, que je pose le cercle de papier et que j’attrape le disque suivant… Il me restait entre 15 et 20 secondes avant que le disque suivant ne démarre ! C’était comme être sur une ligne de production avec des articles à emballer arrivant sans cesse !! C’était de la torture, mais c’est aussi comme ça qu’on apprend à devenir très bon car ce qui importe aux yeux des autres, ce ne sont pas les obstacles que vous rencontrez mais le résultat de vos efforts ! Donc, j’ai pris les choses en main et j’ai fait de ce club la plus grosse piste de danse Afro-américaine de toute la Nouvelle-Angleterre. Il y avait 3 étages où tout le monde se déchaînait. C’était amusant car les gens venaient et ils ne savaient pas pourquoi j’avais cette connaissance de qu’il fallait jouer. Ils demandaient à mes amis : « Mais qui dit à ce blanc-bec ce qu’il doit jouer ? » Mes amis se marraient et disaient : « Pauvre mec ! Ce gars-là en connait plus que toi sur la musique noire ! » Je suis devenu le meilleur DJ de Nouvelle-Angleterre, les gens venaient me demander les titres des chansons que je jouais et je les écrivais sur des serviettes en papier et tout ce qui me tombait sous la main ! Mon nom devenait de plus en plus connu, tout comme ma réputation dans le domaine de la musique Dance.
J’ai fini par monter un magazine dédié à la musique Dance et au divertissement. Il s’appelait Nightfall et fut le premier magazine de musique Dance au monde. C’était quelque chose de très modeste, avec seulement quatre pages, mais il contenait une liste des chansons que je jouais dans une rubrique appelée TC Disco Dozen (TC, c’était mon nom car comme j’étais le premier DJ de Boston, on m’appelait Top Cat). Cette liste ou « Disco Dozen » comme je l’appelais était composée des 12 meilleurs chansons ou albums disponibles à la vente contenant au moins 3 bons morceaux et ça a tellement bien marché que les magasins de disques commandaient les morceaux qui figuraient sur ma liste, les stations de radio m’appelaient pour me demander ce qu’ils devaient passer et tous les bars et les clubs voulaient savoir quelles chansons je trouvais super !
Je me souviens d’un épisode vraiment très spécial dans ma carrière et dont je garde un souvenir éternel. Je jouais au Rhinoceros, un soir de pluie et de brouillard et le club était bondé. Une personne portant un trench blanc avec le col relevé est entrée accompagnée d’un promoteur musical du coin qui s’est approché de ma cabine en verre. Il m’a tendu le pressage promotionnel d’un nouveau morceau qu’il venait de recevoir en disant : « Tu pourrais jouer ça ? La fille qui chante est ici et elle est originaire de Roxbury (une banlieue de Boston). » J’ai fait : « Ok. » J’ai écouté le morceau qui était lent, sexy et extrêmement long ! C’était un peu gênant car la fille était là et le promoteur musical était un type bien que je comptais parmi mes amis, donc il fallait que je fasse quelque chose. J’ai donc mis le disque sur la platine et comme je m’en doutais, la piste de danse s’est vidée. Les gens me jetaient des regard furieux, bras croisés, d’un air dédaigneux. Quand vous êtes DJ, vous connaissez ce regard que seul un patron en colère peut vous lancer quand vous faites une erreur ou que le public est prêt à s’en aller. Mon patron était là avec des amis, assis à une table juste à côté de ma cabine, et il voulait montrer à tout le monde comment j’arrivais à faire les gens se lever, danser, bouger et leur faire faire tout ce que je voulais. Alors, il s’est mis à taper sur la vitre de la cabine en disant : « Enlève cette M**DE ! » Mais je l’ai ignoré ainsi que la foule et j’ai refusé d’enlever le disque. Mon patron continuait à frapper sur la vitre mais je ne le regardais pas et je secouais la tête comme si j’étais en train d’anticiper le disque suivant. C’était tendu car PERSONNE n’a dansé pendant 16 minutes et 54 secondes. Il faut beaucoup de courage pour faire un truc pareil ou alors, une trappe de secours dans la cabine. C’est ce que je dis toujours aux DJs : « Si vous ne pensez pas être capable d’avoir le courage de vider la piste pour quelque chose de nouveau et avant-gardiste dans lequel vous croyez vraiment, ne faites pas ce métier. » Jouer la sécurité et la complaisance sont parmi les choses qui mènent à votre perte. Mais je savais que je faisais le bon choix parce que je pensais que le disque allait faire un carton, et à ce jour, mon vieux patron Jackie Gateman en rigole encore. Il se sent toujours un peu idiot de m’avoir demandé de l’enlever parce que c’était Love To Love You Baby de Donna Summer, une jeune femme de Dorchester dans le Massachusetts, et c’était la première fois que quelqu’un le jouait aux Etats-Unis ! Elle était là, dans le club, et si vous regardez le film Last Dance, il y a une scène avec un disc jockey à qui elle tend son nouveau disque pour qu’il le passe : dans la réalité, c’était moi. C’était plutôt incroyable et je me suis dit que je vivais un moment historique, même si le monde n’en saurait peut-être jamais rien ! Mon message pour les gens et les DJs en particulier, c’est ‘Faites ce que votre coeur vous dit’ car parfois, en suivant la masse, vous échouerez comme tant d’anonymes ! Je préfère échouer misérablement en m’impliquant dans ce en quoi je crois plutôt qu’en suivant quelqu’un qui saute de la falaise sans y croire du tout !
Suite à ça, je suis devenu très populaire, tandis que le magazine devenait de plus en plus influent : les choses allaient vraiment bien. Ce qui avait commencé comme une passion était rapidement en train de devenir ma carrière. Comme mon influence grandissait dans le pays et pas seulement dans la musique Dance mais dans d’autres formes de musique également, j’ai lancé l’un des premiers Record Pools du pays et du monde. A cette époque, il y en avait trois aux Etats-Unis (à New York, à Long Island et à Boston). On a tous commencé au même moment et on a fait un carton car c’était totalement avant-gardiste, sans transition aucune avec le passé, et dans un nouvel état d’esprit d’entreprise à la pointe du progrès ! Nous étions déterminés à nous implanter en Nouvelle-Angleterre. En fait, j’ai lancé le Record Pool par nécessité car à cette époque, quand j’allais voir les labels de disques pour choisir mes disques pour la semaine, je leur disais : « Merci pour les disques ! Je connais d’autres DJS qui jouent dans des supers clubs à Boston et qui aimeraient venir vous voir pour obtenir vos produits… » Mais on me regardait avec horreur et on me disait : « Non, non, non ! On ne veut pas d’eux : ils sont bizarres. On n’a pas besoin de ces excentriques, ils sont ceci ou cela, et ils sont étranges ! » J’ai trouvé que ce refus était une vraie opportunité de changer la façon dont la communié de la musique Dance faisait du business. Vous savez, il fallait en effet être un peu bizarres ou dingues pour jouer de la musique que seuls certains milieux connaissaient à l’époque ! Alors, j’ai demandé aux labels en question : « Pourquoi vous ne me donneriez pas 25 copies de chaque disque que vous recevez et qui peut être considéré comme de la musique Dance et moi, je les distribuerais aux DJs pour vous faire de la pub et obtenir les réactions du public ? » C’est vraiment comme ça que j’ai démarré le ’record pool’. J’ai pris mon rôle très au sérieux et je me suis efforcé de dire à toutes les stations de radio quels morceaux parmi ceux que nous recevions étaient bien pour eux et de donner à tous les magasins de disques la liste de ce que nous allions jouer dans les clubs le weekend suivant. Je disais aux stations de musique black ce qu’il y avait de bien pour elles dans notre stock, et je faisais de même pour les stations pop, les radios rock/alternatif… Je savais les conseiller car j’avais moi-même été un drogué de radio quand j’étais ado et j’avais écouté et absorbé tous les styles possibles. En une semaine, j’étais capable de dire à WRKO, la radio pop numéro 1 sur le marché de Boston : « Je crois que vous devriez passer I Love Music. » Puis, je suggérais à la station rock, WBCN : « Pourquoi vous ne joueriez pas Instant Replay de Dan Hartman ? Il vient du Rock’n’Roll et ça vous permettrait d’atteindre les gens qui se souviennent de lui. » J’ai dit à Sonny Joe White, de la station WILD : « Jouez donc Give Up The Funk (Tear The Roof Off The Sucker) de Parliament ! » Ainsi, j’ai dépassé les frontières des genres musicaux et le ‘record pool’ est passé de 25 personnes à 50 puis à 75, 125, 150 personnes, tandis que notre influence commençait à se répandre dans toute la Nouvelle-Angleterre et bientôt dans tous les Etats-Unis et devenait une force majeure avec laquelle il faudrait compter ! J’ai lancé la première cérémonie de remise de récompenses dans le domaine de la musique dance : ça s’appelait The Nightfall Magazine Awards. Au départ, nous étions 150 dans un petit club de Boston, The Mirage. Quatre ans plus tard, nous étions passés de 150 à 4800 personnes à l’Orpheum de Boston ! C’est nous qui avons révélé Village People, Chic, Evelyn Champagne King, Donna Summer et Peter Brown à Boston, et la première fois qu’ils ont joué aux Etats-Unis, c’était là-bas. Peter Brown, Machine, The Fantastic Four, Loleatta Holloway, Ecstasy Passion and Pain, Odyssey, Dr. Buzzards Original Savannah Band et beaucoup d’autres venaient dans notre ville pour leur promotion et ils expérimentaient l’amour des DJ et des fans pour la première fois, au plus près de la foule… Les gens venaient des quatre coins du pays et de la planète pour assister à nos ‘awards’ car ils savaient ce que nous allions faire pour les rendre eux et la musique Dance légitimes à l’échelle nationale ! Nous avions le soutien et l’admiration des gens dans le monde entier !
Durant les années 70, les maxi 45 tours sont arrivés sur le marché ce qui était une sorte de révolution car ces disques comprenaient de nouvelles versions alternatives des chansons de l’époque. Pouvez-vous nous faire partager vos souvenirs à ce sujet ?
Le premier à avoir réalisé un mix sur un disque était un monsieur du nom de Tom Moulton qui était d’ailleurs aussi de Boston et avait démarré sa carrière en tant que promoteur musical et avait une oreille incroyable et très ouverte. Il avait beaucoup de talent et s’efforçait de s’emparer d’une chanson pour en faire une version longue. Il travaillait sur le son de façon à ce qu’il corresponde aux standards et réponde aux attentes des clubs et des DJs. Il savait déployer un mix mais aussi laisser des respirations : le rendu était incroyable sur les gros systèmes hi-fi des clubs et les versions longues étaient des supers outils pour les DJs !
A l’époque où on a été présenté, j’avais une émission sur la station FM du MIT que j’ai déjà évoquée, WTBS. C’est moi qui l’ai invité pour l’interviewer. Il était très intelligent et passionné, et il me fournissait des acétates de disques qui allaient sortir et sur lesquels il travaillait avant leur mise sur le marché. Je peux ainsi dire sans risquer de me tromper que j’ai été la première personne au monde à jouer le morceau I Need A Man de Grace Jones à la radio, grâce à Tom Moulton. Pour moi, c’était surréaliste de jouer ça sur la radio que j’écoutais dans mon lit quand je n’étais encore un gamin ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’était cool, ni ce que je ressentais d’être enfin à la place dont j’avais rêvé. Ce qui m’avait amené là, c’était mon amour pour le très bon R’n’B progressif et le fait qu’il n’y avait pas d’autre endroit pour en entendre mis à part les radios universitaires, sans oublier le MEILLEUR programme de radio de sa catégorie, à savoir The Ghetto. C’était la planche de salut qui m’avait mené à la musique que j’aimais tant et maintenant, j’avais une émission sur WTBS !
C’était un programme de deux heures qui passait heureusement avant The Ghetto : j’en avais moi-même élaboré le concept qui consistait à s’intéresser à tout ce qui concernait la musique Dance et que j’avais appelé The Right Track : The Music That’s Making America Dance. Je jouais tout ce que je voulais sans aucune restriction ni aucune influence de qui que ce soit sur ma playlist. Je travaillais avec mon ingénieur du son Munib qui était aussi étudiant au MIT et avec qui je m’accordais parfaitement. Je jouais tout ce qui rentrait dans le domaine de la musique Dance, peu importe la longueur du morceau ou le style : du moment que c’était de la bonne musique sur laquelle on pouvait danser, je le jouais et lui donnais du temps d’antenne et de l’exposition. Une fois, j’étais allé danser dans un club de Boston, le CHAPS où le DJ était un copain, Danae Jacovidas, et j’ai entendu le morceau Do It (’Til You’re Satisfied) de B.T. Express. J’avais l’habitude d’entendre la version courte mais cette fois, c’était totalement différent car le morceau se poursuivait avec une seconde partie et je me suis dit : « Waouh, c’est incroyable ! Il me le faut ! » C’était l’une des premières fois que j’entendais un mix de Tom Moulton. Tom prenait donc ces morceaux et en faisait des versions longues. Parfois, il prenait tous les éléments qui se trouvaient sur la version originale et il ajustait les instruments et les niveaux pour rendre le morceau meilleur, plus fluide et facile à danser : il nettoyait les sons, tout simplement. C’est mon respect pour lui qui m’a amené à inclure ses travaux si souvent dans mon émission. J’ai toujours l’acétate original de I Need A Man de Grace Jones que Tom m’avait donné. Les DJs ont immédiatement réagi en l’entendant car c’est à eux que mon émission s’adressait !
Ce qu’il y avait de merveilleux avec les maxi 45 tours, c’est qu’ils attiraient enfin l’attention et faisaient honneur à un genre musical qui était quasi-inexistant jusque là. Personne ne savait qui nous étions ni même comment anticiper ce que donneraient nos efforts : je n’oublierai jamais l’époque de nos premiers succès car c’était le meilleur moment ! Nous n’avions que peu de chances de réussir mais c’est justement ce qui nous a poussé vers les sommets !
Quand j’ai commencé, je suis allé voir une maison de disques locale qui distribuait des disques à tout le monde dans le coin, The WEA Branch (Warner Elektra Atlantic), et je leur ai demandé de me donner des disques à passer en club. A ma grande consternation, ils m’ont jeté dehors car ils ne savaient pas qui j’étais et n’avaient pas conscience du pouvoir des clubs, en tout cas pas encore ! Ils m’ont dit : « Non, on ne fournit pas les DJs de clubs, seulement les stations de radio. Le directeur, Tony, dit que vous feriez mieux de partir parce qu’on ne distribue qu’aux radios ! » En quittant les lieux, épaules basses et égo en berne, j’ai aperçu une benne à ordures verte sur le parking à l’arrière du bâtiment. Le moral plus dégonflé qu’un ballon de baudruche, je m’en suis approché et j’ai commencé à fouiller dedans. Et c’est comme ça que j’ai démarré une partie de ma collection de disques ! J’ai transformé une tragédie en victoire et je suis reparti dans ma petite Volkswagen verte après avoir récupéré deux cartons de disques ! Qui a dit que de nos blessures ne pouvaient jaillir la lumière ?
C’est précisément à cause de ces expériences négatives au début de mon parcours que lorsque quelqu’un me dit qu’il est au bout du rouleau, qu’il se sent frustré et humilié, je comprends instantanément sa souffrance ! Oui, ces choses-là arrivent mais si vous aimez ce que vous faites, ça ne vous atteint pas ! Le rejet vous rend tout bonnement plus fort et plus déterminé à prouver que les gens ont tort ! Quand, tout à coup, j’ai commencé à voir que l’impact de notre communauté Dance sur l’industrie musicale devenait de plus en plus fort, c’était un sentiment formidable qui justifiait tout ce que j’avais traversé !
Rapidement, je devenais une référence dans l’univers de la musique Dance et j’appelais les labels de musique pour leur dire : « Vous devriez faire une version longue de tel morceau » ou bien « Cet enregistrement passerait bien mieux en clubs s’il était un eu plus long ». J’ai même fini par leur conseiller de signer certains disques comme je l’avais fait avec ce groupe The Philly Devotions sur un petit label indépendant de Philadelphie, Don De Records. Leur chanson I Just Can’t Say Goodbye, signée par CBS sur le label Columbia Records, était l’exemple type. On a commencé à voir les 12 pouces sortir, à une grande fréquence. Il y a eu Ten Percent de Double Exposure mixé par Walter Gibbons, mais aussi The First Choice et plein d’autres qui sortaient des disques mixés et produits pour les clubs et mes frères et soeurs DJs ! Cela justifiait tout ce qu’on avait fait pour gagner cette bataille de la reconnaissance de notre art et pour être considérés comme une branche de l’industrie de la musique avec sa propre identité et des gens qui pouvaient s’occuper de ses besoins au niveau des labels.
Les maxi 45 tours étaient faits pour nous ! Ils avaient la bonne intro et de bien meilleurs sons de basse grâce aux bons gros grooves et à la résolution du son qui pouvaient rivaliser avec n’importe quelle production ! C’était génial !
En réalité, la résolution et le son sur un 12 pouces à 45 tours/minute était encore meilleure qu’à 33tours/minute car plus ça va vite, plus il y a d’informations en un temps réduit ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus de son et de séparation de sources. La raison pour laquelle on sortait peu de maxi 45 tours au début, c’est que le nombre de morceaux y était limité et les producteurs avaient peur d’y inclure des chansons longues (de 10 minutes ou plus) car plus on se rapproche de l’étiquette centrale, moins la résolution est bonne. C’était donc très excitant d’entendre toutes ces versions longues et je savais que nous avions accompli quelque chose de spécial pour élever le niveau d’intensité et d’acceptation de la musique Dance en général. Cela a vraiment constitué une avancée du point de vue des formats.
Nous avions enfin réussi à nous débarrasser de notre statut de marginaux pour nous élever dans la douleur et devenir un groupe puissant de personnes quand il s’agissait de découvrir des artistes et de nouvelles musiques ! Les radios avaient des versions de 3 minutes mais nous, dans les clubs et au ‘record pool’, on avait des versions de 5, 7 ou même 12 minutes spécialement faites pour nous inciter à soutenir des artistes ! Nous disposions désormais d’outils sur mesure qui profitaient à notre public. C’était une période très inspirante car après avoir été ignorés et considérés comme inconséquents, nous sommes devenus les avant-gardistes de la musique, et nous méritions cette attention car on l’avait chèrement gagnée !
Vous êtes justement l’un des grands acteurs de cette période. Comment vous êtes-vous fait repérer par CBS Records, au point d’être engagé comme DJ et remixer pour contribuer à ces maxi singles ?
C’était à l’époque où je travaillais à promouvoir la musique, tout en dirigeant mon magazine (Nightfall), mais aussi en jouant à la radio et des clubs, sans oublier ma casquette de propriétaire du Boston Record Pool. Comme je vous l’ai dit, j’avais les stations de radio dans la poche grâce à mon influence et mes suggestions sur ce qu’ils devaient jouer, les labels me connaissaient, ainsi que les magasins de disques et bien sûr, nous avions le record pool donc nous contrôlions toute la ville et même toute la Nouvelle-Angleterre. C’est à ce moment-là que deux messieurs m’ont contacté : Mark Kreiner et son partenaire, Tom Cossie qui travaillait comme vice-président et directeur général chez Buddah Records à New York, et était respecté pour son goût très sûr à sélectionner et à promouvoir de la musique avec succès.
A l’occasion d’un de mes voyages à New York, on s’est rencontré et ils m’ont dit : « John, nous aimerions avoir votre avis sur ce disque. » Ils m’ont donné l’acétate de leur nouvel enregistrement que j’ai écouté et j’ai été bluffé. C’était une chanson vraiment puissante. A cette époque, Billboard répertoriait le top 10 des chansons n°1 de la scène Dance dans les grandes villes telles que Boston, Philadelphie, New York, Los Angeles, etc… Chaque classement de chacune des villes apparaissait sur une page et faisait apparaître quelle chanson était numéro 1 dans chaque ville. Pour établir cette liste, ils interrogeaient un DJ par ville et ils m’ont consulté puisque c’est moi qui représentais la ville de Boston. Après avoir écouté le morceau en question, j’ai fait des copies sur cassettes de l’acétate qu’ils m’avaient remis pour les transmettre à tous les DJ de la ville. La semaine suivante, quand le classement national est sorti, tout à coup l’acétate que ces deux gars m’avaient confié pour savoir si je le trouvais bon, s’est retrouvé numéro 1 à Boston ! Les gens étaient dingues parce que ce n’était qu’un acétate : le label n’était pas spécifié car deux labels se le disputaient encore à ce moment-là (Buddah Records et Atlantic) ce qui a créé une course aux enchères.
Ce disque a attiré l’attention sur notre ville et nous a assuré une crédibilité tout en démontrant ce dont nous étions capables. Cette chanson que vous connaissez sans doute, c’était Dance, Dance, Dance de Chic et elle a fait un carton quand elle est finalement sorite chez Atlantic Records ! Au même moment, Kreiner et Cossie ont lancé leur compagnie, MK Dance Promotion, et m’ont dit qu’ils voulaient que je la dirige mais pour ça, il fallait que je m’installe à New York. Je leur ai répondu : « Euh, moi, je mixe ici et j’ai une émission de radio. Mon magazine est également basé ici donc pour tenir ce rôle, je peux me déplacer ponctuellement à New York et LA, mais sinon, je reste ici, à Boston, c’est ma base. » Ils ont accepté et je me suis retrouvé à la tête de MK Dance Promotion pour les villes de New York, Boston et Los Angeles. On recevait des disques à promouvoir et si je les aimais bien, je disais : « Ok, on y va, on en fait la promo dans les clubs et les radios généralistes ! » C’était vraiment intéressant car par exemple, nous avons lancé Dan Hartman et il est devenu numéro 1 avec un remix réalisé par Tom Moulton. Tout ce qu’on prenait avait de grandes chances d’être un succès car nous avions les clubs et les radios avec nous, ce qui était une combinaison imbattable. On contactait tous les DJs du classement Billboard et j’ai été le premier à engager des DJs de clubs et des personnes du milieu de la musique Dance comme promoteurs. C’étaient des gens supers, de vrais passionnés et nos morceaux étaient toujours diffusés car on s’assurait de choisir de très bons disques avant tout. Si un disque semblait insignifiant, on laissait tomber car ce qui m’imputait vraiment, c’était notre réputation et notre attention à la qualité !!
Un jour, Epic est venu me voir au sujet d’un nouveau disque qu’ils voulaient promouvoir par notre intermédiaire dans les clubs de façon à voir s’ils le soutiendraient et ainsi le proposer aux radios pour espérer passer à un autre niveau. Je l’ai écouté et, très franc comme à mon habitude, je leur ai dit : « Non, on ne prend pas. C’est une bonne chanson mais pas assez bonne pour les clubs. » Cheryl Machat, la directrice de production d’Epic m’a demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas ? » Je lui ai répondu : « Ben, il faut l’accélérer et y ajouter des claps. Il faut que ça pète, il faut du mouvement et des percussions si vous voulez que ça se joue dans le clubs. » Cheryl a dit : « Vous pouvez le faire pour nous donner un exemple ? Je ne comprends pas vraiment de quoi vous parlez : je n’y connais rien ! »
Toujours en quête de tester mes limites, j’ai pensé sans une seconde d’hésitation : « Allez, je me lance et on verra si je J’avais un petit enregistreur 2-pistes TEAC dans mon appartement à Boston et j’ai enregistré le disque sur une des faces de la bande (vous savez, la stéréo était à gauche ou à droite). Je l’ai enregistré plus lentement ce qui fait qu’en le jouant ensuite à la bonne vitesse, le morceau était accéléré. Sur une face, il y avait donc le morceau et sur l’autre, tout ce que j’avais ajouté : des claps, un bruit de salière secouée et toutes sortes de sons qui m’étaient venus à l’idée, réalisés à l’aide de cuillères en guise de tambourins, mais aussi une mélodie que j’avais fredonnée. Je l’ai écouté et je l’ai trouvé plutôt bien, et Epic aussi apparemment puisqu’après l’avoir entendu, ils m’ont demandé : « Ok, est-ce que tu le ferais pour nous, alors ? » J’ai accepté le défi et j’ai dit : « Eh bien, ok, c’est parti ! » J’ai jeté un oeil au dos de mes pochettes de disques et j’ai vu que bon nombre de ceux que j’aimais avaient été enregistrés au studio Media Sound de New York, alors j’ai décidé d’aller le faire là-bas. Ils m’ont envoyé des billets, réservé une limo et un hôtel. Quand j’ai atterri à LaGuardia, la voiture m’a emmené à l’hôtel et je suis allé immédiatement au studio où Susan Planer, la directrice, m’a accueilli en m’annonçant qu’elle avait engagé un assistant ingénieur du son nommé Michael Barbiero pour travailler avec moi. Il n’avait pas fait beaucoup de sessions en autonomie mais il était très bon. J’étais partant et j’ai dit : « Pas de souci : vous me le présentez ? » Moi aussi, j’étais nouveau et ils tentaient le coup avec moi, alors je n’avais rien à perdre ! J’ai donc rencontré Michael et je lui ai donné des instructions : « Je veux que les basses soient énormes, qu’elles entourent le corps ! Il faut que les basses tapent en pleine poitrine. Je veux aussi ajouter des claps. Tu connais un percussionniste ? » Il m’a répondu : « Oui, Jimmy Maelen ! C’est le meilleur ! » Il l’a appelé et j’ai eu de la chance qu’il soit disponible car il venait tout juste de finir des sessions avec Kiss, Roxy Music et les Doobie Brothers, et il était toujours très demandé. J’étais vraiment ravi quand j’ai commencé à travailler sur le morceau, à choisir les décalages et les effets ainsi que les niveaux sonores et vocaux du disque. Rétrospectivement, je sais que j’ai été chanceux car j’avais toute liberté, sans aucune pression ni contrainte d’aucune sorte.
Le disque a été remis à Epic Records, par l’intermédiaire de Cheryl Machat, et est arrivé peu après dans les clubs et sur les radios R’n’B. Lorsque je suis rentré à Boston, Epic avait déjà lancé la machine en éditant quelques copies pour les DJ et à en croire ceux qui les avaient reçu, ça faisait un carton ! Je recevais des appels de DJ de New York du style : « Oh, mon dieu ! John Luongo, c’est un tube de dingue ! » Richie Rivera m’a appelé pour me dire qu’il l’avait joué au Paradise Garage et que les gens étaient devenus fous tandis que Larry et lui le passaient en boucle et que ça cartonnait tant et plus ! Alors, j’ai continué avec le titre Pick Me Up, I’ll Dance de Melba Moore qui est devenu un tube également. Je n’avais jamais mixé un titre en studio de ma vie avant et voilà que j’en faisais deux et qu’ils récoltaient beaucoup d’attention et d’applaudissements ! Après ça, j’ai reçu des coups de fils de partout : du Canada, du Royaume-Uni, de France et d’Espagne. Les labels m’appelaient également : Capitol Records, Columbia Arista Records, EMI et quelques autres qui voulaient tous que je produise, mixe ou même dirige leur secteur promotion de musique Dance et que je refaçonne entièrement leur label Dance parce qu’ils étaient enfin prêts à se lancer. Moi, j’étais déjà un pro et je dirigeais un de ces secteurs tout en continuant de mixer. C’était vraiment une période révolutionnaire pour notre industrie et la musique en général. Mon avocat, Martin Machat, qui était aussi le père de Cheryl, m’a conseillé en ces termes : « Tu sais quoi, John ? Tu devrais monter ton propre label plutôt que de travailler pour les autres. Tu es producteur et tu as bien plus que ça à proposer. Tu n’es pas un businessman à proprement parler : toi, tu es plutôt un créatif. » A cette époque, il représentait Jet Records, Ozzy Osborne et Leonard Cohen, ce qui était plutôt impressionnant. Il m’a dit : « Ecoute mon conseil. Les artistes vont et viennent, mais les producteurs restent toujours ! » Je l’ai écouté et je suis heureux d’avoir tenu compte de ces conseils qu’il m’a offert avec sincérité et amour.
L’album Destiny était un virage important pour les Jacksons, après les ventes décevantes de l’album Going Places. Ressentiez-vous une certaine pression sur leurs épaules au point de vous dire que vos contributions pourraient aider à redorer leur blason ?
C’est un épisode digne d’un livre de contes, quelque chose que je n’oublierai jamais : ce jour où Epic m’a demandé de venir à leurs bureaux situés à l’angle de la 54ème rue et de l’Avenue des Amériques (ou 6ème Avenue), dans ce Black Rock Building comme on l’appelait car c’était un immeuble tout en granite noir. Je me suis donc rendu dans les bureaux de Lennie Petze, le directeur artistique, qui m’a dit : « On a un disque à sortir mais si il ne marche pas, on laisse tomber le groupe. La chanson vient de sortir et elle ne marche pas si bien que ça, c’est moyen. Il faudrait que tu fasses un mix qui la ferait grimper dans les charts et qu’on puisse la diffuser sur les radios R’n’B. Tu peux faire ça ? » Je connaissais la chanson et elle n’avait rien de bien percutant telle quelle donc je sais que je pouvais faire mieux. Je n’avais rien à perdre mais je me suis mis tout seul la pression et j’ai accepté en déclarant : « Oui ! Je peux faire beaucoup mieux que ça ! » J’ai demandé les bandes master 24 pistes, vent de réserver le studio à Media Sound à New York sur la 57ème rue ouest et je suis entré en studio où mon percussionniste habituel Jimmy Maelen n’était pas disponible. J’en ai donc appelé un autre très bon et très connu dans le milieu new-yorkais, Crusher Bennett qui attendait mes instructions.
C’est un morceau pour lequel je ne me suis pas appuyé sur le mantra de la production musicale qui dit que « le moins est le mieux » mais j’ai opté pour beaucoup d’overdubs, en modifiant le tempo, en ajoutant différentes sortes de percussions et en réarrangeant totalement l’enregistrement. Je voulais que les gens sachent que c’était un mix différent et le ressentent dès la première note de façon à capter et à garder leur attention. J’ai utilisé toutes mes nouvelles idées créatives en prenant tous les risques possibles pour en faire quelque chose d’épatant ! D’autres que moi auraient sûrement mixé ça à la manière de Tom Moulton, c’est à dire en conservant la structure originelle du morceau et les pistes telles qu’elles avaient été enregistrées mais en les épurant, sauf que ce n’était pas moi. J’ai donc été le tout premier DJ au monde à ajouter des overdubs sur un enregistrement qu’on m’avait demandé de mixer et à les combiner avec les sons d’origine de façon à créer quelque chose de complètement différent et nouveau.
Auparavant, les morceaux portaient la mention « mixé par » suivi du nom du remixer, mais quand j’ai démarré ma carrière et que j’ai commencé à prendre de l’assurance et à expérimenter des choses, j’ai fait bougé les lignes et j’ai demandé à ce que les labels me créditent avec la mention « mixage et production additionnelle par John Luongo ». J’étais fier de ça car j’allais bien au-delà du mixage traditionnel de l’époque. C’était une grande source de fierté et de satisfaction de savoir que tout ce qu’on entendait en plus de la production et du mixage originels, c’était moi qui l’avais ajouté. C’était un disque très spécial pour moi car j’étais un grand fan du groupe et j’étais heureux de les aider à rester dans les classements R’n’B. Le mix est donc sorti et le disque est immédiatement passé de la 80ème place au top 20. C’est ainsi qu’a commencé le sauvetage du groupe avec le morceau que je venais de remixer qui était Blame It On The Boogie des Jacksons !
Encouragé par ce résultat positif, Lennie Petze (toujours chez Epic) est revenu vers moi et m’a dit : « Bon, super boulot. En voilà un autre : essaie de voir ce que tu peux faire. » Ils m’ont donné un autre morceau qui devait également figurer sur le même album sur le point de sortir. Je suis retourné dans le même studio, sans aucune crainte puisque je n’avais toujours rien à perdre et que le groupe avait besoin de mon travail sous peine de disparaître des radars, en tout cas chez Epic Records ! Cette fois, j’ai retrouvé mon percussionniste de premier choix, Jimmy Maelen, et nous avons réalisé des overdubs et mixé le tout dans le studio du haut à Media Sound. Comme le morceau devait être à la fois un tube de radio et de club, il fallait que j’y aille à fond ou ça ne marcherait pas. J’ai fait venir une batterie électronique (Syndrums) et nous avons ajouté une basse synthétique et toutes les percussions imaginables, et j’ai poussé Jimmy Maelen aux limites de ses possibilités. Nous avions récupéré un tambour de frein sur une automobile que nous avions suspendu à une structure métallique : Jimmy s’est servi des poignées de ses maillets de percussion pour taper sur le tambour ce qui a ajouté une tonalité caribéenne au morceau et l’a rendu plus dynamique. J’étais très content d’être parvenu à atteindre ce que je recherchais et même davantage pour les overdubs, et à la fin de la session, j’avais vraiment le sentiment qu’on allait obtenir quelque chose de super. Il y a des moments où vous savez que vous avez réussi quelque chose de particulier et j’étais impatient de le mixer.
Nous avons bouclé le mixage en 27 heures après de nombreuses modifications. Michael Barbiero et moi avons travaillé non-stop et sans prendre de pauses car nous devions libérer le studio le lendemain. J’ai remis le morceau à Epic qui l’a soumis aux Jacksons pour qu’ils le valident : c’était Shake Your Body (Down To The Ground). J’ai attendu nerveusement leur réaction, pensant sincèrement que j’avais modifié la chanson pour le meilleur et qu’ils allaient l’adorer ! Eh bien, ils l’ont détestée ! Moi qui m’attendais à ce qu’ils regonflent mon égo ! (rires) Ils ne supportaient pas cette version et refusaient de la sortir : ils disaient que c’était le pire truc au monde, tout ça, tout ça… Ils trouvaient que la chanson était totalement transformée, et en effet, c’est ce que j’avais voulu faire. Ça me faisait de la peine mais en même temps, j’acceptais leur décision car mon rôle était de prendre des risques et de donner au client une option complètement différente et une vision alternative. Je me suis donc dit : « Je m’en fiche. Mon boulot, c’est de faire de mon mieux selon ma vision. Je ne vais pas faire un disque « sûr » pour faire plaisir aux gens ! Je me fais plaisir d’abord car si je suis content, alors il y a de grandes chances que tout le monde le sera également ! Je connais mon métier et j’accepte de ne pas toujours faire ce que tout le monde aime ! »
Mais parfois, l’impensable se produit, par ce qu’on ne peut qu’appeler un coup du destin. La bande master de l’enregistrement devait être envoyée à Los Angeles pour y être détruite mais quelqu’un a dû intervertir des choses et elle a été expédiée au Canada par erreur. Là-bas, un des mes amis qui travaillait pour Epic Records, Dominik Zarfka, a vu mon nom sur la bande et s’est dit : « Oh, John Luongo ! J’adore tout ce que fait ce mec ! Il faut que je sorte ce disque ! » Et il l’a sorti. Des gens au Royaume-Uni l’ont entendu et même chose : « Oh, il faut qu’on sorte ce disque ici ! » Et ils l’ont sorti.
Le public ne savait pas que c’était moi car sur certaine des éditions au Royaume-Uni, il était écrit qu’il avait été mixé par « Jim Luongo » : bonjour l’insulte et l’offense ! Pour commencer, on m’avait dit que ce morceau était horrible et voilà qu’il y avait une erreur sur mon prénom. Tout le monde pensait donc que c’était quelqu’un d’autre. Par chance, un exemplaire du disque est revenu aux Etats-Unis et est arrivé jusqu’à la plus grosse station de musique black de Philadelphie, WDAS, où le DJ Joe Tamburo (Butterball) l’a immédiatement passé sur les ondes, et le reste appartient à l’Histoire ! (c’était aussi un album de Michael Jackson, ça, non ? LOL). A ce moment-là, les disquaires et les auditeurs se sont mis à appeler la radio et leur standard a explosé. Tout ceci est parvenu aux oreilles d’Epic car tout le monde les appelait pour acheter le disque ce qui les a pris au dépourvu. En fait, ils ne savaient pas que le disque était sorti et encore moins qu’il leur appartenait !!! Quand ils ont compris, ils m’ont appelé en me menaçant comme jamais : « On va te faire un procès ! On t’avait expressément demandé de ne jamais sortir ce disque, et encore moins ta version ! » J’étais abasourdi mais j’ai répondu : « De quoi vous parlez ? » Je ne savais absolument pas ce qui se passait car je ne m’étais rendu compte de rien vu que j’étais en studio en train de faire un nouveau mix pour un client ! Mais eux croyaient que c’était moi qui avais fait fuité ou sorti le disque et ils étaient très en colère ! Je leur ai dit : « Je n’ai rien fait du tout ! J’ai ma copie de la bande, là, à côté de moi ! »
Le disque se répandait dans tout le pays et ils ont fini par vendre 250 000 exemplaires du Maxi 45 Tours en un rien de temps : c’était une déferlante ! On l’entendait sur toutes les radios, y compris dans l’émission de Frankie Crocker sur WBLS, la station numéro 1 à New York. Frankie m’a appelé pour me demander de lui donner le solo de Syndrum que j’avais utilisé pour le temps fort du morceau : il voulait jouer ce son avant d’annoncer les lettres WBLS. Il m’a dit : « Luongo, donne-moi ce sound de sirène qui monte ! » Vous pensez bien que je l’ai fait !
Environ un mois et demi plus tard, je me trouvais à New York avec Cheryl Machat, la directrice de production qui m’avait entraîné dans cette aventure avec CBS Associated, et elle m’a annoncé : « Il faut que je te dise que j’ai reçu un coup de fil de Joe Jackson qui m’a demandé de te faire passer un message. Il m’a dit de te dire : « Merci d’avoir sauvé la carrière de mes fils ! » J’étais scotché. En l’espace de quelques mois, j’étais passé de « zéro » à « héros » ! Ça a renforcé ma conviction qu’il faut persévérer peu importe ce que disent les gens. Il faut croire en ce qu’on fait !
Peu de temps après, je suis allé à Los Angeles pour de nouveaux contrats avec CBS sur la côte ouest. J’étais tout excité car je devais y rencontrer celui qui avait produit la version originale du disque des Jacksons et qui était la pointure du groupe, à savoir Bobby Colomby, que vous connaissez peut-être aussi en tant que batteur et fondateur du groupe Blood, Sweat and Tears ! Il m’a invité chez lui à LA, et je suis donc entré dans cette maison magnifique qui ressemblait davantage à un musée ! Là, il m’a dit : « Tu vois cette maison ? C’est en partie grâce à ton travail que j’ai pu l’acheter ! » Vous ne pouvez pas imaginer ce que signifiait pour moi d’entendre ça de sa part, car c’était un homme que je respectais. Quant à moi, j’ai dû gagner 500 dollars avec ce disque, mais ça n’a pas d’importance parce que la satisfaction que j’en ai tirée vaut un million et ça m’a aidé à lancer ma carrière dans le monde entier !
Si vous faites des choses que vous aimez, alors tout peut arriver. Si vous restez là à attendre, par contre, rien ne se passera… A partir de ce moment-là, j’étais à fond sur tout ce que je faisais et pas seulement la dance, mais aussi tout ce sur quoi je pouvais me faire la main : le rock, la funk, la musique alternative, le R’n’B, la Pop et même la musique Country. Peu importe ce qu’on me confiait, j’étais focalisé sur le son et avec mon sens de la chanson, je disposais d’une combinaison imparable !
Je ne permettais à personne de me mettre dans une case et à chaque fois que quelqu’un essayait de le faire ou de me coller une étiquette, ça me mettait très en colère car cela laissait sous-entendre que j’ai des limites dans ce que je fais ou ce que je peux faire, et je déteste ça.
Ces petits challenges que je m’imposais à moi-même étaient vraiment mon moteur et m’amenaient à répliquer : « Oh, vous pensez que je ne peux pas faire ce genre de chanson ? Eh bien, je vais le faire et je vais vous montrer qui décide ! » (rires) La seule personne qui peut me juger et me dire ce que je peux faire ou pas, c’est moi et personne d’autre. J’ai eu à faire à quelques sceptiques qui, par jalousie de l’attention que suscitait mon travail, voulaient me cantonner à la musique Dance, ce qui m’a amené à rechercher de nouveaux défis pour me stimuler, mais aussi à rester ambitieux et humble. Si on ne croit pas en ses propres capacités et possibilités, on se réveille pas un matin avec la soif de faire encore plus !
C’est ce catalyseur qui a permis de faire exploser ma carrière. Ma confiance était constructive et mon désir d’être numéro un insatiable. Sur chaque session, j’étais très inspiré et motivé : je tapais dans mes mains pour capter l’attention de l’équipe et je disais : « Il faut qu’on crée un son que l’oreille humaine n’a jamais entendu ! » Je pense que c’était une manière de dire qu’il fallait pousser le bouchon au maximum et qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance dans mon studio et sur mes sessions. On s’amusait beaucoup, mais je restais concentré et on riait surtout pour décompresser de la somme de travail qu’il nous fallait pour mener à bien notre mission et nos objectifs ! Je me souviens que je refusais l’idée que quelqu’un soit meilleur que moi : c’est ce sentiment qui m’apportait une dose très saine de crainte et de respect quand j’abordais chaque nouveau projet ! L’idée que quelqu’un fasse du meilleur boulot ou soit plus créatif que moi, c’était une constante source d’inspiration !
C’est ainsi que les choses ont commencé à grossir de manière exponentielle et que les artistes se sont mis à me solliciter sans arrêt. Il n’était pas rare de recevoir trois ou quatre demandes par semaine de la part de labels majeurs pour travailler sur leur musique ! Je me suis à mixer de tout et j’ai fini par obtenir mon propre label chez CBS Records par l’intermédiaire de Associated Labels. Au début, c’était un peu compliqué : les 2-3 premiers trucs que j’ai sortis étaient bons et auraient dû marcher, mais c’était aussi de ma faute car j’essayais d’être créatif et de gérer l’aspect commercial, et c’est ce qui m’éloignait de l’aspect purement créatif. Et puis, un jour, j’ai proposé un morceau que j’avais signé qui s’appelait Your Too Late de Fantasy : il est devenu numéro 1 dans les classements des clubs et R’n’B. C’était mon premier numéro un sur mon propre label Pavillion chez CBS Records ! Alors, j’ai enchaîné avec le titre Zulu de The Quick qui a aussi fait un tube. Cette fois, mon label était sur la voie du succès.
Mais, en dépit du fait que je réussissais ce que j’entreprenais, CBS continuait d’essayer de m’éloigner de ce que je voulais faire, à savoir explorer d’autres styles musicaux pour développer mon répertoire et faire de mon label quelque chose de tout à fait accompli et légitime qui pourrait rivaliser avec les autres labels chez Associated Labels. A titre d’exemple, la regrettée Ellie Greenwich m’avait parlé d’une rockeuse dont j’avais ensuite vu la formidable performance dans l’émission de télé-crochet Catch A Rising Star. Ellie avait prévu d’écrire pour elle ce qui était un gros plus car c’était une artiste emblématique et une merveilleuse auteure. Lorsque j’ai dit à CBS que je souhaitais la signer, on m’a répondu : « Non, on vous a signé vous et votre label pour une seule raison : pour que vous fassiez de la dance musique. Vous devez nous fournir de la très bonne Dance music. » Ils ne voulaient pas me laisser la signer alors que c’était Patty Smyth qui a fait une immense carrière par la suite en vendant des dizaines de millions de disques après que Columbia Records ait sorti son premier tube avec le groupe Scandal, Goodbye To You. Puis, j’ai découvert un artiste que j’aimais vraiment beaucoup, un gars très talentueux qui s’appelait Eugene Wilde, et que je voulais aussi signer mais encore une fois, on m’a répondu : « Non, tu ne connais rien à la musique noire, alors tu t’en tiens à la Dance. » Les semaines qui ont suivi, un groupe s’est présenté à mon bureau accompagné de leur manager Steve Salem qui voulait que je les mette sur mon label. Et là, vous voyez le tableau, CBS m’a répondu « Non » encore une fois avant de les signer sur Columbia quelques mois plus tard : c’était Full Force, un groupe dont vous avez peut-être entendu parler pour les chansons qu’ils ont faites pour Lisa Lisa et Samantha Fox, devenant ainsi des artistes et producteurs récompensés par de nombreux disques de platine. Là, ça a vraiment commencé à me gonfler !
J’étais blême de colère et totalement frustré : tout ce que je voulais, c’était montrer que je pouvais faire ce que je voulais en matière de musique et réussir !! C’est alors que je leur ai amené deux autres trucs pour prouver que j’avais l’oreille pour tous les styles de musique et ps seulement la dance. L’un des disques m’est parvenu par l’intermédiaire de mon avocat, Marin Machat, qui m’a présenté à un manager britannique, Stevo Pierce, qui est devenu un de mes amis. J’adorais le disque que je trouvais vraiment bon et je pensais qu’il pourrait marcher dans le monde entier. Je le sentais vraiment bien et on m’a confié l chanson et le groupe pour les Etats-Unis et le Canada. J’ai donc sauté sur l’occasion mais malheureusement, j’ai dû laisser tomber car quand je l’ai joué chez Epic Associated dans leurs bureaux new-yorkais, personne n’a percuté. Au final, le titre a fait 8 millions de ventes : la chanson était extraordinaire puisque c’était Tainted Love de Soft Cell.
Enfin, je suis allé dans un club avec mon ami Marc Almond : il avait produit une chanson que j’adorais. On s’était quasiment mis d’accord pour que je le propose à CBS mais je craignais tellement qu’ils me disent de nouveau « non » que finalement, je lui ai dit : « Ecoute, fais comme tu le sens. » Et là, ça m’a rendu fou parce que c’était Madonna !… Alors, j’ai voulu rompre mon contrat mais ils refusaient. Je leur ai dit : « Mon contrat stipule que je ne peux pas produire des disques aux Etats-Unis mais il n’y a rien qui dit que je ne peux pas le faire au Royaume-Uni ! » Donc, je suis parti là-bas et j’ai travaillé pour Visage, Soft Cell…
Chez CBS, est-ce que rencontrer et discuter directement avec les artistes faisait partie de votre tâche ? Si oui, est-ce que cela a été le cas avec Michael Jackson et ses frères ?
Oui, j’ai eu l’opportunité de parler avec Michael. J’ai rencontré son manager, Ron Weisner, qui m’adorait. Avec Freddy DeMann, ils s’occupaient de Paul McCartney, Diana Ross, Gladys Knight, Steve Winwood… Ron savait à quel point je travaillais dur et les Jacksons ont vraiment commencé à s’apercevoir de mon talent lorsqu’ils ont rencontré des difficultés pour que leur disque passe en radio. Ils étaient prévus pour un énorme show au Madison Square Garden mais WBLS refusait de passer leur titre ! Alors, ils m’ont dit : « S’il te plait, John, est-ce que tu peux nous aider et arranger le disque ? » Bien sûr, j’ai accepté. Vous savez, j’aime les gens, et j’aime les rendre heureux et non pas tristes. Je ne me considère pas comme un génie mais j’aime à penser que je suis quelqu’un qui se préoccupe des gens. A cette époque, j’avais remarqué que tous les clubs utilisaient des sons de sirènes et je trouvais ça plutôt intéressant mais aucun disque n’avait un son de sirène. Alors, je suis allé en studio et j’ai loué une sirène avec une manivelle ainsi qu’un énorme gong. Nous avons aussi mis en place des Syndrums. Le disque sur lequel je travaillais était Walk Right Now, et à la seconde même où je l’ai terminé, il est passé directement sur WBLS ! Les Jacksons étaient tellement contents qu’ils m’ont demandé de venir jouer le son de sirène avec eux sur scène au Madison Square Garden ! Mais j’ai refusé en leur disant : « Je viendrai vous voir et je serai ravi de rencontrer tout le monde mais je ne suis pas le genre de gars qui souhaite être sur scène : je préfère rester dans l’ombre. » J’aime me rendre indispensable mais de manière discrète. Michael Jackson m’a rencontré et m’a remercié pour tout ce que j’avais fait. Je suis heureux de savoir que j’ai sauvé leur carrière et je suis fier de faire partie de leur histoire.
Pouvez-vous nous raconter en détails vos travaux pour vos versions de Blame It On The Boogie et Shake Your Body ? Aviez-vous accès aux multi-tracks ?
Oui, je pouvais enlever tout ce que je n’aimais pas et ajouter tout ce qui me semblait nécessaire, et pour cela, j’avais besoin des multi-tracks. De nos jours, il est très facile de prendre une piste vocale et d’y ajouter la musique. Les gens pensent que les DJs actuels font du super boulot mais non, ça n’a rien de super car ils ont juste la liberté de faire ce qu’ils veulent. J’aimerais bien qu’ils essaient de travailler sur un morceau conçu d’une certaine manière en tenant compte de ses paramètres d’origine et qu’il sonne toujours aussi bien. Moi, je croyais au fait de rendre l’artiste, le groupe et la chanson meilleurs sans toucher à l’intention première du morceau. Et non pas juste s’en emparer et y ajouter des « bang, bang, bang » : ce n’est pas du génie, ce n’est pas créatif ! Je prenais des morceaux funky ou rock et je les amenais à leur maximum de possibilités. Par exemple, après avoir mixé Dude (Looks Like A Lady) d’Aerosmith que seulement 15 stations de radio passaient, plusieurs centaines de stations se sont mises à le jouer. Et ça sonnait toujours comme un morceau d’Aerosmith au point que le batteur m’a appelé pour me dire : « C’est trop bien, mec ! C’est exactement ce que je voulais ! » Steven Tyler aussi m’a dit : « Luongo, t’es un p***** de dingue ! » (rires) Le but, c’est d’essayer de travailler à l’intérieur du cadre de ce qui existe déjà plutôt que d’avoir la liberté de faire tout et n’importe quoi.
Est-ce que Michael et ses frères vous ont fait part de leur avis sur vos mixes et/ou ont-ils collaboré directement avec vous lors de vos travaux ?
Non, parce que la règle, c’était : « Dites-moi tout ce que j’ai besoin de savoir avant de commencer et ensuite, fichez-moi la paix ! » (rires) Je ne fais jamais rien qui risque de limiter ma créativité, me rendre frileux ou à la botte de quelqu’un. Si je veux modifier quelque chose qui ne me semble pas convenir, je le fais de la manière qui me semble la meilleure. Si je veux créer une nouvelle mélodie, même chose, point barre !
Avez-vous remixé d’autres titres pour les Jacksons qui sont restés inédits ?
Il me semble que mon remix de Can You Feel It n’est sorti que sur un disque promo. Vous savez, parfois vous faites un mix et il y a un long délai pour que le vinyl soit pressé du fait de la paperasse qu’il faut préparer des mois à l’avance. C’est pour ça que je ne suis pas forcément crédité sur toutes les choses que j’ai faites : ça n’apparaît pas toujours.
Mais il n’y a pas eu d’autres morceaux, non, car je n’étais pas tout le temps disponible. En fait, j’étais tellement sollicité que c’était « Premier arrivé, premier servi ». On pouvait me demander pour une vidéo de Gladys Knight et la semaine suivante, je recevais un coup de fil en urgence : « S’il te plait, on a besoin de ton aide pour une chanson. Tu peux trouver un créneau ? » Et je me retrouvais en studio pour travailler sur le morceau All She Wants To Do Is Dance de Don Henley. A cette époque-là, je ne sortais quasiment pas des studios : j’y étais jour et nuit et pour des choses toujours différentes ! Queen, Kiss mais aussi des groupes complètement dingues et très étranges comme Psychic TV ! Dans ma tête, je pensais : « Waouh ! » Mais j’aimais tellement la musique et ce que je faisais. C’était à la fois très amusant et un travail si intense que je n’avais plus vraiment de vie personnelle mais ça allait. Quand je regarde en arrière, je me dis : « Quelle chouette vie ! »
En 1980, lorsque l’album Triumph arrive chez les disquaires, Michael Jackson sort d’un succès en solo avec Off The Wall. Est-ce que vous ressentiez alors que son statut avait déjà changé lorsque vous travailliez sur Walk Right Now ?
Oui, je voyais bien qu’il devenait un artiste solo. Il commençait à se distancier de façon à être une entité par lui-même et il me semble qu’il était plus à l’aise ainsi. C’était un artiste incroyable mais il était d’une telle timidité ! Quand on lui parlait, on avait l’impression d’être face à Bambi. Il venait seulement de comprendre qui il était et ce que je trouvais formidable, c’est la façon dont Quincy Jones parvenait à être une figure paternelle pour lui. Quincy a eu l’intelligence d’apporter des orchestrations très riches, profondes, denses, puissantes et élégantes de façon à des chansons « urbaines ». Ainsi, Michael Jackson est devenu le prince de la musique des rues d’une manière élégante. Quincy Jones était l’un de mes héros dans le monde de la musique : je voulais devenir comme lui parce que c’est quelqu’un qui connait la richesse des orchestrations, des cordes et qui sait vous faire ressentir la musique. Un jour, à un séminaire, j’ai eu la chance de le croiser et je lui ai dit : « Je voudrais juste que vous sachiez à quel point vous êtes une inspiration pour moi et que c’est un honneur de rencontrer un de mes héros. Merci beaucoup ! » Quand je lui ai dit qui j’étais, il a répondu : « Il faut que vous sachiez une chose également : j’ai utilisé vos idées pour les percussions sur Off The Wall. » Waouh. Je garderai ça au fond de mon coeur pour toujours.
En 2008, les albums Triumph et Destiny des Jacksons sont réédités et c’est l’occasion d’entendre vos contributions qui sont ajoutées à la track-list. Avez-vous été consulté et qu’avez-vous ressenti en apprenant cette nouvelle ?
On ne m’en a pas parlé, non, mais j’ai l’habitude de ne pas être crédité. J’ai fait des milliers de disques qui ont été des tubes. Pourtant, certaines personnes obtiennent davantage de publicité que moi mais c’est parce qu’elles paient pour ça. Comme je dis toujours : « Ma musique, c’est ma réputation, ma carte de visite. Elle parle pour moi. » Mais ma plus grande récompense, c’est quand des DJs venaient me dire : « Tu sais, à chaque fois qu’on voyait le nom de John Luongo sur un disque, même si il débarquait le vendredi soir juste avant qu’on aille au club, on le prenait avec nous pour le jouer en premier parce qu’on savait que tu ne nous laisserais pas tomber et que tu avais fait un disque qui était respectueux de notre travail, parce que tu te préoccupes de nous et de notre public. » Pour moi, c’était magique d’entendre ça. La magie du respect que te portent ceux que tu aimes vraiment énormément. Je n’ai jamais oublié les DJS, je les aime, j’en ai moi-même été un et c’est comme ça que j’ai commencé. C’est donc un honneur de savoir que les gens qui m’ont façonné sont les mêmes qui me respectent aujourd’hui. Ce sont mes fondations qui me permettent de rester humble.
Avez-vous écouté les remixes des chansons de l’album Xscape de Michael Jackson sorti en 2014 ? Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Celui à Justin Timberlake chante avec Michael ? C’est la pire, la plus atroce et horrible chose… Voyons voir si je peux le dire mieux encore ! Il n’y a avait aucun sentiment, aucune sensibilité. Si Michael Jackson ne l’avait pas sorti, c’est parce qu’il n’y avait pas la bonne énergie et c’est une honte de s’emparer que quelque chose qu’il ne trouvait pas à la hauteur. Mais tout d’un coup, alors qu’il n’est plus là pour s’y opposer, on trouve un gars pour chanter : ça ne se fait pas ! Vous imaginez Van Gogh qui aurait dit au sujet d’une de ses peintures : « Je ne vais pas la présenter. » et puis, les gens, eux : « Oh, regardez ça ! Si on le vendait pour des millions ! » Le plus bel hommage qu’on puisse rendre aux grands de ce monde, c’est que le dernier aperçu que les gens aient de leur existence soit à la hauteur de leur grandeur. Michael aurait détesté ces morceaux et il ne les aurait jamais laissé sortir. La façon dont cela a été fait est tellement simpliste : on se croirait revenu à l’époque où il n’avait pas de succès. Il y avait beaucoup de choses horribles dans ces morceaux et ils les ont laissé passer dans le but d’essayer de faire de l’argent. Lui, il en aurait fait des chansons sensibles, avec des sentiments et de la hauteur, en un mot, merveilleuses !
Quel est votre secret pour parvenir à offrir une version alternative sans dénaturer l’âme de la chanson ? C’est justement ce qui caractérise vos travaux.
Travailler sur les morceaux que l’artiste vous confie et tenir compte de la façon dont ils ont été créés. Ecouter la musique et en connaître l’histoire, ce qui la chose la plus importante que les jeunes DJs doivent faire de nos jours. Je voudrais faire comprendre à tous les DJs du monde, même ceux qui rencontrent un succès immense, qu’ils ne seront plus là dans 3 ou 4 ans s’ils ne savent pas apprécier ce qu’il y avait avant eux et évoluer ans leur style. Il leur faut apprendre à écrire des paroles, à capturer une mélodie complexe, bref, s’investir dans leur travail. Le secret, c’est d’écouter l’histoire, l’étudier, ne jamais penser qu’on sait tout mais aussi écouter les gens qui sont en train de construire le futur. De cette façon, ils pourront prendre le meilleur du passé, le meilleur de ce qui est à venir et les mélanger pour en faire des morceaux magnifiques. S’ils continuent à faire tout le temps la même chose, la magie va disparaître. Ils doivent grandir avec leur public et relever des défis. J’avais coutume de dire : « Si vous devez échouer, la meilleure manière de le faire, c’est en essayant d’être numéro 1. » Jouer la sécurité, c’est la pire chose que vous puissiez faire car ça vous rend complaisant et la complaisance est quelque chose dont on ne peut plus s’échapper ensuite. Il faut constamment rester sur le fil et essayer de faire ce qu’on peut pour se sentir plus à l’aise, sans jamais croire qu’on sait tout ni se reposer sur ses lauriers. Je ne regarde jamais en arrière, du côté des disques que j’ai faits, sauf quand je parle à des gens comme je le fais là, mais je fais des tas de choses pour le présent et l’avenir qui détermineront qui je suis réellement. Il me reste encore beaucoup à faire pour continuer à être heureux et à grandir dans le futur.
Au final, dans toute votre discographie, quelle place tiennent vos contributions pour les Jacksons ?
En toute confiance et connaissance de cause, je peux affirmer qu’elles figurent parmi les choses qui me sont les plus précieuses. Mais ce qui a encore plus de valeur, c’est de se dire que sans Epic Records et toutes les choses formidables qu’ils ont faites pour eux, les Jacksons se seraient fait jeter. C’était une super boîte pour eux : ils avaient la meilleure attachée de presse du monde en la personne de Susan Blond et la plus merveilleuse équipe de promotion. Je ne pense pas qu’un autre label ou une autre maison de disques aurait fait aussi bien qu’Epic. Lennie Petze aussi a fait un super boulot avec eux. Une de mes plus grandes réussites, c’est d’avoir rendu les Jacksons incontournables. Je suis aussi très fier de savoir que ce sont les boîtes de nuit de la planète entière qui ont sauvé la carrière des Jacksons ! Quelle meilleure façon de mettre un point final à l’épisode de déni et d’inutilité qu’ont subi les DJs ? J’en ai des frissons rien que d’y penser… Tous ces DJs qui étaient les parias, les étrangers et les lépreux de la société se sont révélés être leurs plus merveilleux soutiens et ont aidé à sauver leur carrière. Un bon point pour eux et pour la musique dance !
https://www.johnluongomusic.com/
© 2017 John Luongo Music – Permission expressly granted for use by John Luongo Management, LLC.